Jardins d’Eden, une nouvelle (1998)
Cette nouvelle avait gagné en 1998 le prix du Rotary-Club de Bourges.
Je découvrais l’énorme plaisir d’être lue et appréciée par des personnes inconnues, extérieures au cercle des intimes. C’était le prélude d’un dialogue.
Les années passent et l’écriture s’enrichit du chemin parcouru, mais je note que je me plaçais déjà dans le domaine de la recherche de la sensation, abordant le thème de la liberté et de la fabrication de l’identité auxquels je suis encore fidèle.
Merci, si jamais ils se retrouvent ici, à ces lecteurs de Bourges qui m’avaient encouragée. Je n’ai pas oublié la soirée passée avec eux, ni leur chaleur envers une débutante.

Jardins d’Eden
Enfant, Flora passait la plupart de ses vacances chez sa grand-mère du Midi. La vieille femme occupait seule une maisonnette à la sortie d’un village, une sorte de chalet en bois qu’un fermier avait construit sur une dépendance de son terrain et qu’il lui louait pour une somme modique. Le chalet était minuscule, une grande pièce où l’on mangeait et deux petites chambres, aussi vivait-on surtout au grand air.
C’était un pays de montagnes, mais de montagnes du Midi, les hivers étaient rigoureux mais courts, les étés chauds, et les saisons intermédiaires douces et clémentes. L’on s’en revenait de vacances calme et regonflé par l’air qui sentait bon le thym et la sarriette, la chèvre et le champignon.
La grand-mère de Flora était une infatigable marcheuse, une femme des espaces ouverts et des crêtes d’où l’on domine les cirques majestueux et les crêtes où l’on n’est pas. Elle avait horreur de ce qui était domestique et fuyait ce qui obstruait son passage, les murs, les portes, jusqu’à la vue des palissades des maisons du village. Elle ne cultivait rien autour de son chalet, disant qu’elle trouvait tout ce qu’il lui fallait poussé à l’état sauvage, et que la montagne était ce vaste jardin que devait être à l’origine le jardin d’Eden. Elle le parcourait sans cesse en tout sens, en ramenant odeurs et saveurs.
Elle portait un chapeau de paille piqué de fleurs sauvages ainsi qu’un large tablier qu’elle remplissait de jeunes pousses et de simples. Flora pensait qu’en d’autres temps sa grand-mère eut été une sorcière. Elle n’aimait rien tant que la suivre sur les chemins caillouteux et l’entendre marmonner le nom des plantes qu’elles rencontraient. Le pas de la grand-mère était vif, mais ses arrêts fréquents permettaient à la petite fille de la rattraper. Elle caressait les cheveux de l’enfant, tendre et un peu absente, le nez suspendu à des fumets que Flora ne sentait pas, l’oeil furetant au ras du sol à la recherche de quelques végétaux rares, ou perdu vers les hauteurs qu’il embrassait royalement comme si tout le pays était sien.
– Alors, ma Biquette, tu l’aimes mon jardin?
Comme sa grand-mère, Flora était chez elle dans ces espaces non clôturés. Elle apprit à reconnaître l’aigremoine, l’armoise, la marjolaine et l’absinthe, et jusqu’aux saisons de leur ramassage le plus propice. Elle parlait patois avec les bergers, buvait aux cours d’eau sans se mouiller les pieds, chassait le petit gris et le sanguin, et disputait les baies aux oiseaux. C’était des vacances de pur délice, elle courait, elle marchait, elle se fondait avec les éléments, et pleurait amèrement quand il fallait partir. De retour en ville, elle était surprise de la crasse, de la rareté de l’air, du grondement continu des rues. Il fallait réapprendre la terrible finitude de ce qui chez sa grand-mère était infini. Elle se cognait aux meubles et faisait se retourner les têtes dans la rue où sa voix claire avait sonné trop fort. Elle lisait dans le regard de sa mère la compréhension d’une ivresse depuis longtemps tenue à distance.
Les petites vacances, Flora les passait dans la région parisienne, chez ses grands-parents paternels. Ils s’étaient retirés à l’âge de la retraite dans une maison construite dans les années soixante pour y passer les fins de semaine. A cette époque, leur maison, moderne et fonctionnelle, était un spécimen parmi les fermes, mais lorsque Flora était enfant, la plupart des fermes s’étaient transformées en résidences secondaires, de nombreux champs avaient été lotis et la route était terriblement passante. Il était strictement interdit à Flora d’ouvrir la grille d’entrée.
De toute façon, dans cette maison-là, la vie se tenait toute entière de l’autre côté, dans le jardin des grands-parents. Il était de taille moyenne, mais il était sublime. Flora voyait bien que tous les voisins étaient jaloux. Les grands-parents ne cultivaient pas moins de trente variétés de légumes et vingt-cinq de fleurs. Il en venait à toutes les saisons et l’organisation de leurs cueillettes était au moins aussi compliquée et rationnelle que l’organisation de l’espace en carrés et en lignes. Un ordre des plus rigoureux régnait, régentant la place exacte de l’utile et de l’agrément.
Dans cet univers chatoyant mais strict, pas une mauvaise herbe ne survivait aux regards de Cerbère des grands-parents, pas une chenille, pas une limace ne s’en sortait indemne. Et Flora, elle aussi, filait doux entre les allées de carottes, de choux et de radis qu’elle admirait tout autant que les dahlias, zinnias et capucines. Elle se voyait, Flora, comme une sorte de miracle de la nature, une espèce hybride issue d’un croisement rare entre une famille sauvage du Midi et une espèce francilienne plus commune, mais admirable de vigueur et de fidélité. D’ailleurs, l’espèce menaçait de s’en tenir à elle seule, prototype expérimental: ses parents lentement se lassaient l’un de l’autre et lorsque disputes et réconciliations tarirent, il y eut le départ de son père.
Flora était solide et ses racines assez profondes pour tenir durant ces temps difficiles. Elle grandit. Elle cessa de passer les vacances chez ses grands-parents, découvrit les bords de mer et les capitales étrangères. Son grand-père mourut, puis sa grand-mère paternelle. C’étaient des années trop remplies pour réaliser leur perte. De temps à autre, Flora envoyait une carte postale à sa grand-mère du Midi. On disait dans la famille que la grand-mère avait trouvé la plante qui rend immortel.
Il y eut ce bel amour. Et puis ce gros chagrin. Il y eut ce désir de ne pas y survivre, ce sentiment écoeurant de ne plus pouvoir imaginer l’avenir sans Lui, ni même aucun lendemain. Flora découvrit la fadeur des jours devenus incolores. On lui dit: « Pars Flora, ressource-toi… Va voir l’Océan, les plages de sable fin, va danser sous les cocotiers et croquer les fruits pulpeux de l’exotisme ! »
Flora entra dans une agence de voyages et elle en ressortit. Au milieu des catalogues, surgis on ne sait comment, s’étaient imposés à elle les jardins de son enfance. Elle téléphona à son père qui lui apprit la vente de la maison de ses parents. Sa gorge se serra à la pensée des allées régulières envahies par l’herbe folle.
Restait le Midi. Flora remplit sommairement un sac de voyage et prit le train de nuit: il lui semblait impossible de remonter le temps en quelques heures confortables d’un train à grande vitesse. Au matin, épuisée par des rêves de pertes irrémédiables, elle monta dans un bus qui la déposa au village de sa grand-mère. La veille, elle lui avait parlé au téléphone. La très vieille dame avait marmonné des « très bien, très bien » et avait raccroché sans que Flora sût si l’information de sa venue avait été comprise.
Elle posa le pied sur le sol en tremblant. La tête lui tournait mais l’air vif des montagnes la ranima d’un coup. Elle s’élança. Quelques regards de vieillards assis au soleil s’attachèrent à elle et son cartable d’écolière lui pesa dans le dos. Elle s’étonna de ses chaussures à talons et du journal qu’elle tenait plié sous le bras. La place du village n’avait pas changé, elle.
La grand-mère paraissait avoir rétréci tant elle était menue. Ses paupières comme des pétales fanés lui tombaient sur les yeux et elle posait sa main en cornet sur l’oreille lorsque Flora parlait.
– Alors Grand-mère, comment ça va ?
Elle raconta pêle-mêle le dénuement de son grand âge, énumérant les unes après les autres les infidélités de son corps. Flora n’écoutait qu’à moitié. Elle avait sans hésiter retrouvé le chemin qui menait au chalet et l’avait reconnu, même s’il était désormais complètement cerné par des murets crépis dont dépassaient des portiques de balançoire et des fils couverts de linge. L’intérieur était conforme à ses souvenirs, sauf que ne s’y trouvait plus qu’un très strict nécessaire.
– Grand-mère, pourquoi est-ce si vide chez toi ?
– Je n’ai plus besoin de rien.
– Qu’as-tu fait de tes affaires ?
– Je les ai données. Je vais m’en aller bientôt.
– Il ne faut pas dire cela.
– Si, si. Je suis très malheureuse. Je ne peux plus marcher, j’ai tout le temps froid, j’ai mal partout, je ne supporte rien de ce que je mange, c’est fini.
Flora entendait les mots mais elle n’y croyait pas. Elle ne pensait qu’à aller dans la montagne.
– On va se promener un peu, dis, Grand-mère ?
– Non, non, je ne peux plus.
Flora insista mais sa grand-mère s’en tenait à son refus. Flora partit seule.
Elle prit la petite route et longea les barrières, dépassant les jouets d’enfants épars, les mobiliers de jardin en plastique blanc, les gazons bien entretenus. Elle avait peur d’être déçue, de retrouver les montagnes diminuées et sans force. Ou communes, semblables au reste du monde. Elle avait peur qu’elles ne soient devenues touchantes et misérables et que les souvenirs qu’elle en avait se révèlent n’être que d’illusoires fantasmes de la nostalgie.
Elle fut près du ruisseau en quelques minutes à peine. Les bas-côtés étaient secs mais un pied de ciguë lui fit de l’oeil. Elle s’agenouilla devant ses ombelles blanches, étalées pour la séduire. Le souvenir de leur toxicité lui revint, et elle n’y toucha pas. Au moins ce jardin-là, négligé et sauvage, était-il resté le même.
Le chemin montait raide. Flora marchait de son pas de gamine en vacances, s’arrêtant sans cesse puis accélérant à nouveau vers la crête. Quand elle y fut, elle s’engagea dans une prairie d’herbes sèches et monta plus haut encore. Le souffle lui manquait. Elle n’y prêta pas attention. Elle savait qu’un sentier commençait derrière le bois de pins, qui menait à une bergerie. Elle reconnaissait les bruits, les odeurs. Elle savait qui elle était, et pourquoi elle était là. Elle monta des heures durant, découvrant à chaque crête une crête toujours plus haute qu’il lui fallait atteindre pour assouvir sa faim. Il lui semblait rentrer chez elle après un long voyage.
Lorsqu’elle fut de retour, sa grand-mère parut surprise.
– Je pensais que tu ne reviendrais pas, que les montagnes t’avaient prise, ou un beau berger.
– Voyons Grand-mère, je suis devenue raisonnable.
La grand-mère recevait une voisine et la femme inconnue lui dit qu’elle n’avait pas changé, qu’elle avait toujours le même regard myope. Flora comprit que la femme la confondait avec sa mère.
La voisine avait les bras chargés de divers objets dont la grand-mère se débarrassait, casseroles, coussins, couvertures. Toute une vie.
– Il y a encore un lit pour moi cette nuit ?
– Votre grand-mère m’a demandé d’apporter un matelas et un sac de couchage. Ils sont là.
– Ah…
– Et j’ai mené du fromage et du pain. Ca ira ? Demain vous irez au restaurant. J’ai réservé. Ca lui fera la fête à votre grand-mère. Elle n’a plus guère d’occasions.
La grand-mère n’écoutait pas. Elle était sur le seuil et regardait la nuit tomber. Alors, la voisine tira Flora à l’écart et lui chuchota que l’agriculteur qui louait la maison depuis cinquante ans était mort et que son fils désirait récupérer son bien. Flora était sidérée: « Mais il ne peut pas attendre, non ? » « De toute façon votre grand-mère, elle ne peut plus rester ici toute seule. Elle pourrait se faire mal… »
Plus tard, la grand-mère dit à Flora: « C’est décidé. Demain, je viens avec toi. »
Flora dormit mal, le matelas était maigrichon, le silence trop profond. Au matin, elle entendit les oiseaux piailler, et aussitôt, la grand-mère remua dans sa chambre. Une belle journée s’annonçait.
Elles sortirent alors que le soleil montait, irisant les brumes blanches qui tapissaient le fond de la vallée. La vieille dame peinait. Flora avait le coeur serré. La vieille avait mis son chapeau de paille et il semblait l’avaler toute entière. Elle s’appuyait sur un bâton. « Je l’ai trouvé au ruisseau. Il est juste à ma taille. C’est du noyer. » Elle trouvait donc toujours tout ce qui lui était nécessaire ? « Oui, toujours. Tu vois, j’ai mal partout mais je me suis conservée. Finalement, je n’aurai jamais été à l’hôpital que pour mes accouchements… » Passant devant d’énormes touffes de thym, la grand-mère s’arrêta quelques instants, secouant le feuillage de petits gestes rythmés, semblables à ceux d’un coiffeur faisant gonfler une chevelure. L’odeur montait, grisante.
Au détour d’un sentier, s’arrêtant à nouveau, la grand-mère rectifia une boucle de verdure, lissa un rejet rebelle. Flora s’émerveillait: les gestes de sa grand-mère étaient gravés en elle comme des gènes dominants. La vieille dame parcourut du regard la végétation alentour, comme une mère inspecte ses enfants avant la sortie hebdomadaire dans la belle-famille et, d’un geste ample, elle désigna la montagne: « Alors ma Biquette, tu l’aimes mon jardin ? » Comme Flora acquiesçait, la vieille lui prit la main et la serra jusqu’à lui faire mal. « Quel beau matin, Biquette, je vais en profiter. Tu vas redescendre, t’occuper des dernières bricoles, et je resterai ici, dans mon jardin. »
Flora cherchait à deviner si sa grand-mère plaisantait.
– Voyons grand-mère, qu’est-ce que tu racontes ?
– Il faut bien finir quelque part. Tu hésiterais, toi ? Un tout petit tas d’os parmi les cailloux du sentier, de ceux que tu ramenais autrefois, fière d’avoir trouvé un fossile…
Flora chercha du secours autour d’elle, mais la montagne était déserte, paisible et souriante. La grand-mère s’assit sur une pierre un peu grosse qui semblait avoir été posée là spécialement pour elle.
– Ecoute, Flora, tu commences à descendre et je te rejoins, d’accord ?
Flora redescendit doucement. Les cailloux crissaient dans son dos, mais elle n’osait se retourner. Trop vite, le clocher du village se profila. Une multitude d’oiseaux piaillaient, cachés dans les feuillages. C’était une belle journée.

La grande touffe d’herbes ( Das Grosse Ravenstück ) d’Albrecht Dürer peut être admirée au Graphische Sammlung de l’Albertina de Vienne. C’était la première fois sans doute (1503) qu’un pissenlit, un pied de plantain et des graminées grandeur nature, petites choses naturelles sans importance, devenaient sujet d’une peinture. Ecrire ou dessiner l’instant où le regard s’est posé sur ces petites choses là et le retranscrire de manière universelle, une recherche qui n’est pas neuve.




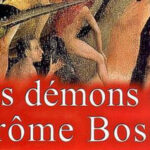


quelle gracieuse histoire ! Un peu mélancolique tout de même. Je donnerais n’importe quoi pour retourner moi aussi dans les jardins de mon enfance mais ma grand mère a disparu depuis longtemps.
Eh bien voila une histoire où architecture et urbanisme sont bien des parallèles de nos existences. Si la nostalgie s’exprime ici c’est bien au regard des espaces de liberté qui s’érodent lentement (peut être vite).
En tous cas c’est cette approche là qui m’atteint dans ce texte.
Germinal
Avec le recul, c’est aussi cela qui me frappe dans ce petit texte, la disparition irréversible de lieux et d’espaces, dont le statut n’est désormais plus qu’ « intérieur, imaginaire » . Après, la question est celle de la perte, car l’imaginaire a tendance à embellir le réel, donc le souvenir, et c’est cela que je pourrais nommer « nostalgie »:cette fabrication a posteriori de moments, personnes, et lieux perdus. Et peut-être, comme dit la chanson de Barbara: il ne faut jamais retourner sur les lieux de son enfance »… La nostalgie apporte plus que la déception, je crois.
bonjour
je suis arrivée sur votre site en tenant le livre que vous avez écrit sur Odilon redon les attaches invisibles
je suis partie bien plus tard 🙂
sans doute en etant dans la 2eme partie de ma vie , la gd mère , la promenade , cette nouvelle trotte dans ma tête je viens l’a relire encore et encore (en tout 4 fois 😉 , je me suis permise de l’a partager avec des amies de lectures sur Facebook ,
chère Alexandra,
je relis quelques années après ta nouvelle. Elle m’émeut toujours autant.Je ne dois pas être la seule, mais bien sûr cette magnifique nouvelle me ramène à nouveau à ma propre enfance. Une grand-mère en région parisienne avec un jardin potager, de fleurs et d’arbres fruitiers (elle nourrissait toute la famille) et une grand tante à la montagne, dans les alpes du sud que je suivais inlassablement des journées entières pour ramasser les champignons, les herbes et d’autres plantes que j’ai, contrairement à toi, totalement oubliées. L’histoire me parait moins triste que lors de la première lecture. Depuis tu nous parles de ton jardin semi-cultivé semi-sauvage. C’est une belle continuité que tu partages avec tes enfants en plus.