Pour justifier les larmes de demain

Forêt de bouleaux en automne, 1903
Gustav Klimt, Vienne, Osterreichische Galerie
Je m’interroge sur l’essence de la vie et l’écriture est sans aucun doute le lieu idéal de cette interrogation.
Je sors de plus d’un an et demi de travail dans le cinéma. Cela ne m’était encore jamais arrivé de passer d’un film à l’autre, ni d’être confrontée à tant de plaisir dans ce métier, à tant de responsabilités et de pression. Le travail rémunéré a un tel prestige dans notre société qu’il vous permet de tout mettre de côté et vous donne toutes les excuses pour être fatiguée, indisponible, absente, pour repousser les pensées, les ennuis, et les obligations – et je l’oppose ici à l’écriture, ce labeur incompréhensible à ceux qui ne le connaissent pas, et qui plus est inutile économiquement et que tous idéalisent sans le respecter jamais. J’ai donc pendant plus de un an et demi nié certaines réalités qui m’entouraient pour mieux donner forme, sens, rythme et brillant aux films que je montais.
C’est terminé pour un temps. Et avec succès pour certains de ces films. Ce qui est évidemment bon pour mon ego, ma position sociale.
Je me retrouve dans l’automne, saison de tous les questionnements, saisons où les dépressifs dépriment face aux jours qui raccourcissent, aux végétations qui fanent, à l’hiver et aux froids qui menacent.
Je me retrouve face à des journées qui demandent à être remplies, face au sens de la vie.
Cette expression peut paraître ronflante, mais il s’agit pourtant bien de cela. Cette liberté des artistes non employés que nous envient les salariés, doit être disciplinée, emplie par la seule force de notre volonté. Je me retrouve face à mon envie d’écrire, et à la difficulté d’écrire. Face aux questionnements sur le sens de cette souffrance que l’on s’impose pour parvenir à écrire quelques lignes qui n’iront pas à la corbeille au lieu d’aller au cinéma ou de visiter ses amis.
J’ai pris comme allié un livre. Je lis Karl Ove Knausgaard, un auteur norvégien né la même année que moi, dont le déballage intime et lucide de sa vie, son œuvre – est pour moi la grande rencontre de cet automne – me donne l’énergie de me jeter dans ce court texte que vous lisez à cet instant. Ainsi que je l’écris souvent, le principal effet de l’art sur moi (et je peux dire la même chose de la nature) est d’éveiller ce que j’appelle l’inspiration, cette sorte de transe, d’éveil puissant aux idées, cette universalité et ce partage de la sensation du monde grâce à un autre qui est un peintre, un écrivain, un musicien, ou juste les reflets du soleil sur un verger de pommiers chargés de fruits.
Me voilà donc avec mon temps libre, mais confrontée brutalement à ce que je fuyais depuis des mois, la lente progression de la maladie dans le corps et l’esprit de ma mère. Et donc face à ce que la société peut appeler responsabilité, mais aussi face à toute notre histoire, qui va du moment où je sors de son ventre à aujourd’hui, et aussi face à celle qu’un jour je serai, puisqu’ après la disparition de nos parents, nous prenons place en tête du peloton.
Non loin donc, tel l’automne, ma mère semble avoir atteint les limites de ce qui donnait du sens à sa vie. Les rêves de voyages, le plaisir qu’elle tirait à enseigner bénévolement la lecture à des analphabètes, l’espoir de tout quitter pour redémarrer dans un nouveau lieu, tout cela est désormais derrière elle depuis que la maladie avance, accélère son entreprise de destruction la transformant en en être dépendant des autres, sans cesse fatigué et lui ôtant toute possibilité de fuir pour aller vivre ce qui lui plaît au lieu de subir ce qui lui déplaît.
Face à ce constat d’anéantissement programmé de cette personne, avec qui mes relations ne sont pas faciles et ont toujours hésité entre révolte et asservissement, me voilà donc forcée de me demander quelle genre de vie elle pourra maintenant mener alors qu’elle déclare, et de fait elle m’a habituée à ce discours depuis l’enfance, (mais pour la première fois, je l’écoute au lieu de le repousser avec horreur) qu’elle ne veut pas de la vieillesse, que la vie qui l’attend n’a plus de sens, que son corps est trop douloureux, et que sa propre présence lui pèse, avec elle, le retour des cauchemars de l’enfance, des souvenirs de la guerre, enfouis toute sa vie dans l’action, et qui s’en donnent à cœur joie désormais pour imposer à la femme âgée les traumatismes de l’enfance.
Et donc qu’est-ce ce que c’est que la vie ? Pourquoi vivre dans la douleur ? Dans l’angoisse ? Avec l’absence de tout espoir et face au mur infranchissable de la dégradation quotidienne de cette maison qui est l’unique que nous possédions, notre corps ? J’ai toujours pensé que la lutte serait mon choix. Que vieille femme, j’aurais encore des envies, que je pourrais commencer à étudier le japonais à cent ans, pourquoi pas. Qu’avec internet, on est relié au monde, on peut suivre sa folie, ses délirantes accélérations et ses beautés aussi. J’ai le souvenir de mon admiration pour un ami qui mourait trop jeune et à petit feu d’une maladie terrible et semblait se réjouir de chaque jour qu’il avait gagné et tentait de lui donner un sens. Mais bien sur je n’étais pas dans son intimité. Peut-être ce courage bravache qu’il me semblait avoir dans la maladie était-elle un fantasme de ma part face à ce manque de pudeur et à cette violence désespérante dont me semblent toujours empreintes les tirades maternelles sur la mort et la vieillesse ?
Je ne juge pas. Ou plus. Je tire de la souffrance de ma mère, et de mon impuissance, dans mon refus d’y faire face, ces quelques mots, qui viennent donner une forme à mes interrogations sur le désir d’écrire, sur le sens à donner à ces heures qui sont chaque matin un don, et qu’il faut remplir d’efforts, de sueur, de larmes, pour que parfois, rarement, la joie de vivre, comme le chantait si bien Barbara, vienne tout effacer, tout illuminer et justifier les larmes de demain.



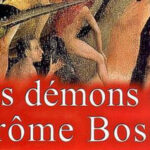


Merci Alexandra pour cet échange si touchant, ce questionnement éternel.
Qu’est-ce que créer, qu’est-ce que la vie ? Pour quoi, pourquoi vivons-nous
et créons-nous ? L’automne nous mène indiciblement à ces mystères, à travers
la perte des formes extérieures, la décomposition. Mais les feuilles jaunies qui ont
connu la plénitude de l’été, avant de reposer sur le sol humide qui leur servira
de tombeau, sont poussées inexorablement par les bourgeons qui se préparent
déjà et sont prêts à traverser l’hiver avant de resplendir eux-mêmes de toute leur
splendeur.
Merci Alexandra, pour ce texte que je lis ce soir en rentrant d’une visite à ma mère dans sa maison de retraite, seul lieu où elle puisse vivre à cause de sa maladie. L’installer dans ce lieu fut une épreuve pour ses onze enfants -c’est à moi, qu’est revenu la charge de lui faire faire le voyage entre sa maison et son dernier lieu de vie. Et pourtant, aujourd’hui elle apprécie le fait d’être bien entourée par le personnel et les visites de ses enfants : les unes très régulières de par la proximité d’un lieu de vie à très épisodiques pour des raisons inverses.
Néanmoins, je ressens comme toi ce moment de déclin physique (elle était plus grande que mois, aujourd’hui elle m’arrive tout juste à la poitrine), sans oublier la dégénérescence de la mémoire qui malgré tout peuvent nous permettre de rire ensemble car un de ses traits de caractère est l’humour… Ma solution, j’évacue le plus vite possible les questions faisant appel à la mémoire des personnes et des lieux, surtout ses proches car cela la désespère, pour se concentrer sur son environnement, les mathématiques, la philosophie et des jeux de mots où elle reste imbattable !!!
Et oui, c’est pour nous demain … et serai-je aussi forte ?
Je pense souvent que non et espère une fin plus rapide pour moi !